L'Emorisation
Quels sont les avantages de l’émorisation® ?
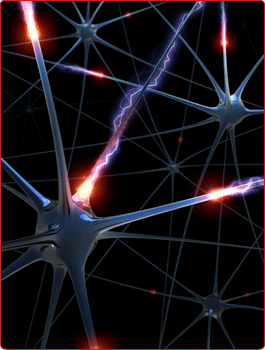
Quotidiennement notre cerveau reçoit un nombre incalculable d’informations, mais seules celles qui auront été associées à une émotion forte resteront gravées dans notre mémoire »
L’émorisation est une méthode unique qui apporte un retour sur investissement rapide et significatif. Dans les SEMINAIRES, une sensibilisation à l’international de tout le personnel de l’entreprise, même pour ceux qui ne sont pas directement concernés. Dans les FORMATIONS, une réelle transformation de vos collaborateurs.
Dans l’animation de votre prochain séminaire et devant TOUT le personnel de l’entreprise.
L’expert se met en scène en jouant un One Man Show ! Les apports interculturels sont facilement mémorisés grâce à la conférence théâtralisée qui apporte le soutien émotionnel indispensable. Des objets et des messages clefs créent une véritable dynamique. Laurent Goulvestre est le seul expert, en France, à se mettre en scène pour bousculer les esprits de tous les collaborateurs.
Dans les formations interculturelles pour des participants ciblés exports ou autres, des outils tels que des jeux de rôle, des études de cas impactent en profondeur vos collaborateurs. Avant et pendant la formation, les participants travaillent sur leur profil culturel qui va permettre à la fois de se positionner et de positionner culturellement ses partenaires pour en réduire tous les écarts.
Définition du marquage émotionnel
« Que faisiez-vous :
- le 11 septembre 2001 lorsque vous avez appris l’attentat du World Trade Center ?
- à la naissance de votre premier enfant
- lorsque vous aviez appris la mort d’un personnage célèbre pour lequel vous aviez de l’intérêt ?
- etc. »
Si vous vous concentrez quelques secondes sur ces évènements, vous vous souviendrez sans doute du lieu où vous vous trouviez et de la manière dont vous l’aviez appris. Plus celui-ci vous a ému et plus le souvenir sera clair et précis. Face à une émotion importante, votre cerveau a imprimé ces informations qui semblent indélébiles dans votre mémoire. Ce phénomène, abordé pour la première fois par Gal Richter-Levin de l’université de Haifa, est appelé marquage émotionnel.
Comment fonctionne le marquage émotionnel ?
Toutes les informations qui entrent dans notre cerveau passent d’abord par le cerveau émotionnel avant d’entrer dans le cerveau de la réflexion. En utilisant l’humour avec des visuels et des objets singuliers, Laurent Goulvestre fait passer des messages qui sont retenus par tous. Pendant les formations, des jeux de rôle sur des cas réels bousculent les esprits. Les collaborateurs devront aussi s’engager en se plaçant eux-mêmes sur une grille culturelle et deviendront acteurs de leur situation. La force des émotions va modifier en profondeur les comportements. Le rire, la détente, la mise en situation inhabituelle interpellent tout le monde. L’émotion est utilisée ici comme MARQUEUR COGNITIF.
Mais pourquoi l’émotion est un marqueur dans la mémoire ?
Notre cerveau est composé de trois étages et deux lobes gauche, droite.
- 1. Le premier étage est notre plus petit cerveau, il est apparu à l’époque primitive et agit sur nos instincts primaires et s’appelle le cerveau reptilien. Il correspond aussi au premier étage de la pyramide de Maslow, celui des besoins physiologiques.
- 2. Avec l’apparition des mammifères, un nouvel étage est venu se greffer sur le cerveau reptilien : le cerveau limbique. Celui ci contient notamment le thalamus sensoriel, l’amygdale et l’hippocampe. C’est le cerveau de l’émotion, il est là pour ressentir et non pour analyser les informations venant de l’extérieur. Les amygdales (à ne pas confondre avec les amygdales de la gorge) situées à côté de l'hippocampe dans la partie frontale du lobe temporal, sont essentielles à notre capacité à ressentir les émotions. Quant à l'hippocampe, il est impliqué dans le stockage et la remémoration de souvenirs explicites (par exemple : le feu ça brule). Sa structure neuronale est simple pour un traitement rapide de l’information.
- 3. Notre troisième et dernier étage est le Néocortex. Celui-ci analyse de façon précise les situations (était-ce vraiment du feu, de quel type, quelles sont les actions suivantes à engager pour soigner cette brulure). Sa structure neuronale est beaucoup plus complexe mais c’est ce qui va permettre une analyse précise des faits et engager un processus de réparation si nécessaire.
En conclusion : les informations passent d’abord par le Limbique avant d’aller dans le Cortex
L’émotion et l’apprentissage
Les modes d'apprentissage de l’Education Nationale et des formations « classiques » privilégient le savoir. Le formateur est présent dans la salle et transmet sa connaissance de façon neutre, voire même parfois monotone et sans réelle interactivité. Or, si le cortex analyse et traite correctement l’information donnée par le formateur, il la retient rarement puisque nous avons vu que le cerveau se stimule de façon ascendante, en commençant par le limbique afin de stimuler la mémoire.
Ainsi, quand on écoute de la musique, ce sont les premières secondes qui sont importantes. Si celle-ci nous plait, le cortex prendra le contrôle de la main qui saisira ainsi le CD afin de l’acheter. Par contre, si le « limbique » ne s’est pas ouvert, le cortex restera neutre et il y a fort à parier que le CD restera aussi sur l’étagère du magasin...
On voit ainsi que la motivation pour apprendre, ou encore engager une action, est un processus qui vient en grande partie d’éléments extérieurs – de façon exogène - et donc de l’environnement. Il s’oppose, de fait, à l’autosuggestion faite à partir du cortex que l’on retrouve dans la méthode Coué. Un autre exemple marquant est le fait d’essayez de s’endormir quand on se le dit. Il y a fort à parier pour que dans la plupart des cas cela nous tienne plus éveillé qu’autre chose.
Il en est de même pour le manager qui comprend vite l’inutilité de dire en permanence à ses collaborateurs « Motivez-vous !», allez, « Bougez-vous, soyez plus efficace ». C’est uniquement en mettant en place des éléments dans l’environnement du collaborateur : prime, possibilité de promotion, nouvelles responsabilités, plus de sens dans les tâches que celui-ci se mettra en mouvement.
En construisant des conférences, des formations et du coaching spécifique qui déclenchent de l’émotion chez le collaborateur, son thalamus sensoriel va générer de la noradrénaline qui va, à son tour, activer les récepteurs de l’amygdale. Ces derniers, en accordant une connotation émotive à l’information, vont la mémoriser facilement en activant l’hippocampe. Le fait de sensibiliser systématiquement le cerveau limbique en amont devient alors une méthode infaillible.
L’émorisation positive
Qu’elle soit positive ou négative, l’émotion favorise donc l’apprentissage. Cependant la qualité de « fixation » de ce que l’on retient est différente selon le type d’émotion vécu. En ce qui concerne l’émotion positive, on retient plus d’éléments en cohérence avec la globalité d’une situation. Pour ce qui est de l’émotion négative, la mémoire est focalisée sur des détails précis, au détriment de la vision globale. Les exercices proposés sont donc liés à des émotions positives et toutes les connaissances transmises pendant la formation sont ancrées dans la mémoire à travers cette technique.
Cette méthode unique et éprouvée depuis 15 ans va enfin vous apporter un véritable retour sur votre investissement formation et séminaire !
Bibliographie :
(1) McDonald, Robert J.; White, Norman M.Triple dissociation of memory systems: Hippocampus, amygdala, and dorsal striatum. Behavioral Neuroscience, Vol 107(1), Feb 1993, 3-22.
(2) DANIEL L. SCHACTER « à la recherche de la mémoire, le passé, l’esprit et le cerveau » traduction de la 1ère édition américaine par béatrice Desgranges et Francis Eustache
(3) MORRIS J.S., FRISTON K.J., BÜCHEL C., YOUNG A.W., CALDER A.J., & DOLAN R.J. (1998) : A neuromodulatory role for the human amygdala in processing emotional facial expressions. Brain, 121 : 47-57.
(4) G. Richter-Levin, & L. Akirav, « Emotional tagging of memory formation – in the search of neural mechanisms », Brain research reviews, vol XLIII, n°3 2003
(5) Anne Jolly «évènements traumatiques et état post-traumatiques : une revue de la littérature épidémiologique » annales Médico-Psycologiques, 2000, 158(5), 370-378.










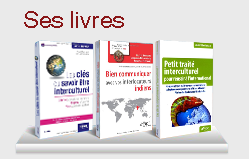


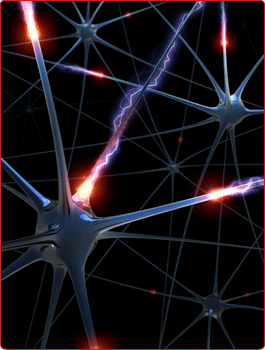 Quotidiennement notre cerveau reçoit un nombre incalculable d’informations, mais seules celles qui auront été associées à une émotion forte resteront gravées dans notre mémoire »
Quotidiennement notre cerveau reçoit un nombre incalculable d’informations, mais seules celles qui auront été associées à une émotion forte resteront gravées dans notre mémoire »
 MicroSystem
MicroSystem